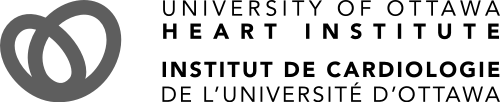Sur cette page
Personnel
Anciens membres du laboratoire
- Xue-Wei Guo
- Samir Hazra
- Varun Kapila
- Alexander Kulik
- Daniel McKee
- Jimmy Song
- Erik Suuronen
- Geeta Waghray
- Serena Wong
Intérêt principal
Dans notre laboratoire, nous tentons de vérifier cette assertion à l’aide d’une variété de modèles expérimentaux et nous examinons le mode d’apparition du phénomène et les moyens de le contourner, si possible. Nous étudions le recours à une modification de la diète et aux matériaux issus du génie tissulaire pour améliorer l’état du tissu hôte ainsi que pour implanter des cellules dans le tissu pathologique et en accroître la rétention.
La thérapie cellulaire de régénération du muscle cardiaque et de son irrigation sanguine fait l’objet d’une évaluation, au même titre que de nouvelles stratégies qui visent à offrir un milieu mieux adapté aux cellules implantées pour accroître leur effet thérapeutique. Nous prévoyons qu’une amélioration du milieu de régénération ainsi que celle du nombre et de la fonction des cellules transplantées fera en sorte que nos nouvelles stratégies liées au génie tissulaire rendront éventuellement l’humain plus réceptif aux thérapies cellulaires. Notre objectif ultime est en effet de rendre plus efficace, sur le plan clinique, cette forme de traitement très prometteuse tout en assurant son innocuité.
Projets
Angiogenèse matricielle et cellulaire
Toutefois, au cours des dernières années, un traitement expérimental appelé « angiogenèse cellulaire » a vu le jour. Ce traitement reproduit fidèlement le processus naturel de formation des vaisseaux sanguins qui intervient durant la croissance et le développement. Très prometteuse en ce qui a trait à la maladie du cœur, cette avenue donne de meilleurs résultats si elle est réalisée avec les cellules extraites de la moelle osseuse ou du sang du patient. L’angiogenèse cellulaire, qui exige l’utilisation de cellules, vise à recréer les processus auxquels chaque adulte a été soumis lorsqu’il était bébé. De nouvelles artères se formeront autour du cœur pour prendre le relais de celles qui sont endommagées.
Dans ce projet, le Dr Marc Ruel et Erik Suuronen dirigent une équipe qui étudie de nouveaux moyens de faire croître et d’implanter un type particulier de cellules dans le cœur. Les cellules qui présentent un intérêt, appelées « cellules souches endothéliales », ont le potentiel de créer de nouvelles artères et peuvent être obtenues à partir d’une simple analyse sanguine. De nouvelles techniques de culture servent à faire croître et proliférer ces cellules, et on travaille à la mise au point de solutions pour les réintroduire dans le cœur endommagé. Pour y parvenir, il faudra utiliser différentes substances novatrices issues du génie tissulaire comme véhicule de distribution. Ces matériaux injectables se solidifient lorsqu’ils atteignent la température du corps, fournissant ainsi un squelette optimal pour les cellules qui seront implantées dans le tissu endommagé.
À ce jour, les études cliniques ont montré que la thérapie cellulaire, bien que bénéfique, se révèle encore beaucoup moins efficace chez les patients que chez les modèles animaux utilisés pour la recherche. Cette divergence s’explique sans doute par le fait que les tissus humains sont plus âgés et pathologiques que les tissus animaux, mais il reste encore beaucoup à vérifier en ce qui a trait à la façon dont cette différence influe sur le rétablissement de l’organe dans la thérapie cellulaire. Ces recherches nous amèneront à vérifier la véracité de cette assertion à partir d’une variété de modèles expérimentaux, et d’examiner en profondeur de quelle manière elle survient et peut être contournée. Nous explorerons l’utilisation de matériaux issus du génie tissulaire en vue d’améliorer l’état du tissu hôte, d’apporter des cellules dans le tissu pathologique et de rehausser la rétention des cellules greffées. Nous prévoyons qu’une fois le milieu de régénération, le nombre et la fonction des cellules greffées seront améliorés, nos nouvelles stratégies de génie tissulaire rendront les humains plus réceptifs aux thérapies cellulaires. En réalité, sur le plan clinique, nous aspirons à rendre efficace cette forme très prometteuse de traitement tout en assurant son innocuité.
Les traitements d’aujourd’hui sont de nature « mécanique » et ne guérissent pas la maladie du cœur. Sans créer de nouvelles artères, on ne peut pas s’attendre à un succès de longue durée. Le processus d’angiogenèse n’est pas mécanique, mais biologique; il s’agit d’une façon naturelle d’obtenir le développement de vaisseaux sanguins. Ce processus, qui réalimentera le cœur en oxygène et en rétablira la fonction, fait partie des thérapies futures et constitue un champ de recherche majeur en ce qui concerne l’innovation dans le traitement des cardiopathies ischémiques.
Thérapie cellulaire pour le traitement de l’infarctus du myocarde
La thérapie cellulaire est devenue une avenue prometteuse pour le traitement de la déficience de la fonction cardiaque subséquente à un infarctus du myocarde. Des études expérimentales chez l’animal et de récentes études cliniques chez l’humain ont mis en évidence les limites actuelles de la greffe cellulaire, dont le faible taux de survie des cellules, un greffage insuffisant des cellules et une mauvaise différenciation. Toutefois, des données probantes obtenues avec des animaux portent à croire que l’utilisation de matrices tridimensionnelles améliorerait la thérapie cellulaire et la formation du tissu myocardique grâce à une amélioration de la rétention, de la survie, de la différenciation et de l’intégration des cellules initiales. À ce jour, seules les matrices biologiques préparées à partir d’organes ou de tissus décellularisés ou d’un tissu poreux obtenu par réticulation de fibres de collagène ont montré de la contractilité in vitro. La contractilité rapportée est toutefois faible.
Ce projet propose la mise au point d’une matrice de collagène injectable qui contient des facteurs de différenciation particuliers en vue d’améliorer la croissance et le maintien des cardiomyocytes. Les cellules souches et les progéniteurs capables de former un nouveau muscle cardiaque feront l’objet d’essai où interviendront ces matériaux d’échafaudage. Leur capacité à améliorer le remodelage, la cicatrisation et la contractilité cardiaques sera testée sur des modèles animaux de myocarde infarci.
Thérapie cellulaire pour le traitement du myocarde hibernant
L’angiogenèse cellulaire reproduit fidèlement le processus naturel de formation des vaisseaux sanguins qui intervient durant la croissance et le développement. Ce traitement très prometteur en ce qui a trait à la maladie du cœur semble donner de meilleurs résultats s’il est réalisé avec les cellules extraites de la moelle osseuse ou du sang du patient. L’angiogenèse cellulaire, qui exige l’utilisation de cellules, vise à recréer les processus auxquels chaque adulte a été soumis lorsqu’il était bébé. De nouvelles artères se formeront autour du cœur pour prendre le relais de celles qui sont endommagées.
Dans ce projet, nous faisons appel à de nouvelles méthodes et à des matériaux novateurs pour implanter un type particulier de cellules dans le cœur. Ces cellules peuvent donner lieu à de nouvelles artères, et nous avons mis au point de nouvelles méthodes pour les réintroduire dans le cœur ischémique. À l’aide d’un modèle qui reproduit fidèlement la pathologie du cœur humain, nous évaluerons les effets des cellules souches sanguines (introduites avec et sans matrice de biopolymère destinée à améliorer la viabilité et la rétention cellulaires après l’implantation) sur la perfusion, le métabolisme et la fonction myocardiques en utilisant la tomographie par émissions de positons (TEP) et l’échocardiographie. Celles-ci constituent des outils diagnostiques intéressants qui permettront d’évaluer le rendement des cellules et des matrices de biopolymères dans le cœur endommagé.
Programme de fonction et d’imagerie moléculaires
Le Programme de fonction et d’imagerie moléculaires (FIM) est un projet de recherche multidisciplinaire financé par une subvention de la Fondation des maladies du cœur de l’Ontario. Le programme a pris de l’ampleur : de 15 stagiaires qu’il comptait en 2006, il est passé à 35 étudiants des cycles supérieurs, chercheurs-boursiers du niveau postdoctoral, médecins résidents et boursiers en 2009. L’examen des modifications de la fonction métabolique et cellulaire observées dans la pathophysiologie des maladies cardiovasculaires qui concourent à la dysfonction myocardique et à l’insuffisance cardiaque, de même que de leur réponse aux interventions thérapeutiques, constitue le thème central qui anime ce groupe. Même si le groupe a recours à différentes méthodes d’évaluation, le lien central demeure les capacités uniques d’imagerie moléculaire qu’offre la tomographie par émissions de positons (TEP).